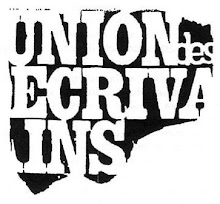Manifeste de la pensée insoumise
Dans les journées qui ont suivi le 12 juin de la grande machination électorale, à Téhéran, une balle des miliciens bassidji a tué au coeur la jeune philosophe Neda Agha Sultan.
Elle était simplement parmi les manifestants, dont la protestation “considère comme illégitime tout gouvernement qui ne respecte pas la volonté du peuple”, comme vient de le dire l’ayatollah Montazéri, jadis successeur désigné de Khomeini, le fondateur de la République iranienne. Là où “la confiance est perdue”, où “nous avons tous perdu dans cette élection”, selon les termes de l’ancien président de la République, Rafsadjani, actuel président du Conseil des experts qui a élu l’actuel Guide suprême Khamenei. Il est entendu en effet maintenant que 31 millions de voix seraient allées à l’opposition : 19 à Moussavi et 12 à Kharoubi – contre 6 millions à Ahmadinejad.
Qui est Neda Agha Sultan ? Une jeune femme qui travaillait “sur Descartes, Nietzsche, Avicenne”.
Descartes : le nom qui signifie l’exploration de la puissance infinie de la pensée, découverte au cœur du doute.
Nietzsche : le projet qui explore le mouvement de la transvaluation de toutes valeurs, entrepris par “la mise en garde devant tout événement”. Et pour qui le devenir est “plus profond et plus métaphysique que l’être”.
Avicenne, Ibn Sina : le penseur persan, le grand philosophe-médecin du Traité de la Shifâ, de la Guérison, percevant la ‘métaphysique’ comme la discipline de la pensée qui, plutôt que de survenir ‘après la physique’ - comme l’indique la racine de ce mot grec transcrit passionnément en arabe - doit intervenir avant l’exploration de la science, comme un préliminaire critique.
Ainsi le soulignait avant lui déjà Alfarâbi, l’énigmatique philosophe persan ou turc de langue arabe né au coeur de l’Asie, dont Avicenne découvrait à Boukhara déjà, en manuscrit, le bref et étincelant “Essai sur la métaphysique” : comme la pensée de la définition ou de la limite.
Or l’appel des manifestants prend maintenant des formes nouvelles. Ainsi en célébrant le quarantième jour depuis la mort de Neda Sultan, le 30 juillet, qui était aussi l’anniversaire de la mort de Sohravardi, le philosophe et poète de la pensée qui fut executé en 1191 sur l’ordre du fanatisme. Neda signifie l’appel, en persan. Son nom est désormais l’appel à la lutte contre la tyrannie du ‘Guide” qui a pris finalement parti pour un ‘président’ faussement élu.
Contre la tyrannie, l’intolérance et la bêtise, sont appelés tous les démocrates du monde. Les journées qui se succèdent depuis le 20 juin prennent la forme d’un appel permanent “contre un islam rigoriste et idéologique”. “Contre mensonge, violence et répression”.
Neda est aujourd’hui devenue à Téhéran le symbole de la liberté et de l’espoir dans l’avenir. Elle demeure le symbole d’un Iran qui vient. Face à l’Iran du pouvoir d’aujourd’hui, appuyé sur des milices tueuses et des services secrets, soutenus à l’étranger par ceux du FTB de Poutine, experts en meurtres camouflés et en police anti-émeutes. Ainsi dans les manifestations du peuple iranien, on entend le cri de : “mort à Poutine !”.
– Moins de vingt jours après la violence qui tue Neda à Téhéran, une autre forme de la violence vient frapper et aveugler, à Montreuil, en France, le 8 juillet, le jeune cinéaste Joachim Gatti, petit-fils du grand créateur de théâtre, Dante Armand Gatti. Certes il ne manifestait pas contre l’élection faussée d’un président, mais simplement contre l’expulsion d’un pacifique squat d’immigrés.
Quand la maire de Montreuil, Dominique Voynet, a questionné la sécurité de Saint-Denis sur ce tir meurtrier par flash ball, le haut gradé des services policiers a donné cette réponse, cette ‘justification’ sans doute à ses yeux : “en Iran la police tire sur les manifestants”...
Sous la violence du tir et la douleur, le visage ensanglanté, Joachim Gatti est jeté à terre. “Cinq d’entre nous ont été blessés et j’ai perdu un œil.” Il ajoutera : “Il m’en reste un, et la détermination à continuer.”
Depuis 2002 l’usage du flash ball est autorisé, et la police de proximité a été supprimée, au grand renforcement des ‘forces de l’ordre’. L’effet clair, bientôt ne fut-il pas le déferlement des voitures brûlées ? Mais le flash ball ? Est-ce devenu le symbole, ‘adouci’ pour l’usage ’occidental’, de la violence d’Etat ?
La démocratie trop policière serait-elle au fanatisme totalitaire ce que le flash ball dans les yeux est à la balle au coeur ?
Mais en antithèse, ce que les splendides trilogies dramatiques de Dante Gatti – Le Poisson Noir, La vie d’Auguste G., Sacco Vanzetti, réfléchies dans La Parole errante – seraient au grand triptyque philosophique qui était cher à Neda : Descartes, Nietzsche, Avicenne, prolongé par Sohravardi.
A travers le triptyque que travaillait Neda, dans Téhéran soudain enflammée par la provocation du mensonge électoral, le monde entier peut désormais entendre le propos cinglant du Zarathustra nietzschéen : “l’Etat, c’est le plus froid de tous les monstres froids, il ment froidement, et voici le mensonge qui suinte de sa bouche : moi, l’Etat, je suis le peuple..”
Le visage de Neda dessine la limite où un peuple cesse de supporter le mensonge d’Etat.
Nietzsche : le projet qui explore le mouvement de la transvaluation de toutes valeurs, entrepris par “la mise en garde devant tout événement”. Et pour qui le devenir est “plus profond et plus métaphysique que l’être”.
Avicenne, Ibn Sina : le penseur persan, le grand philosophe-médecin du Traité de la Shifâ, de la Guérison, percevant la ‘métaphysique’ comme la discipline de la pensée qui, plutôt que de survenir ‘après la physique’ - comme l’indique la racine de ce mot grec transcrit passionnément en arabe - doit intervenir avant l’exploration de la science, comme un préliminaire critique.
Ainsi le soulignait avant lui déjà Alfarâbi, l’énigmatique philosophe persan ou turc de langue arabe né au coeur de l’Asie, dont Avicenne découvrait à Boukhara déjà, en manuscrit, le bref et étincelant “Essai sur la métaphysique” : comme la pensée de la définition ou de la limite.
Or l’appel des manifestants prend maintenant des formes nouvelles. Ainsi en célébrant le quarantième jour depuis la mort de Neda Sultan, le 30 juillet, qui était aussi l’anniversaire de la mort de Sohravardi, le philosophe et poète de la pensée qui fut executé en 1191 sur l’ordre du fanatisme. Neda signifie l’appel, en persan. Son nom est désormais l’appel à la lutte contre la tyrannie du ‘Guide” qui a pris finalement parti pour un ‘président’ faussement élu.
Contre la tyrannie, l’intolérance et la bêtise, sont appelés tous les démocrates du monde. Les journées qui se succèdent depuis le 20 juin prennent la forme d’un appel permanent “contre un islam rigoriste et idéologique”. “Contre mensonge, violence et répression”.
Neda est aujourd’hui devenue à Téhéran le symbole de la liberté et de l’espoir dans l’avenir. Elle demeure le symbole d’un Iran qui vient. Face à l’Iran du pouvoir d’aujourd’hui, appuyé sur des milices tueuses et des services secrets, soutenus à l’étranger par ceux du FTB de Poutine, experts en meurtres camouflés et en police anti-émeutes. Ainsi dans les manifestations du peuple iranien, on entend le cri de : “mort à Poutine !”.
– Moins de vingt jours après la violence qui tue Neda à Téhéran, une autre forme de la violence vient frapper et aveugler, à Montreuil, en France, le 8 juillet, le jeune cinéaste Joachim Gatti, petit-fils du grand créateur de théâtre, Dante Armand Gatti. Certes il ne manifestait pas contre l’élection faussée d’un président, mais simplement contre l’expulsion d’un pacifique squat d’immigrés.
Quand la maire de Montreuil, Dominique Voynet, a questionné la sécurité de Saint-Denis sur ce tir meurtrier par flash ball, le haut gradé des services policiers a donné cette réponse, cette ‘justification’ sans doute à ses yeux : “en Iran la police tire sur les manifestants”...
Sous la violence du tir et la douleur, le visage ensanglanté, Joachim Gatti est jeté à terre. “Cinq d’entre nous ont été blessés et j’ai perdu un œil.” Il ajoutera : “Il m’en reste un, et la détermination à continuer.”
Depuis 2002 l’usage du flash ball est autorisé, et la police de proximité a été supprimée, au grand renforcement des ‘forces de l’ordre’. L’effet clair, bientôt ne fut-il pas le déferlement des voitures brûlées ? Mais le flash ball ? Est-ce devenu le symbole, ‘adouci’ pour l’usage ’occidental’, de la violence d’Etat ?
La démocratie trop policière serait-elle au fanatisme totalitaire ce que le flash ball dans les yeux est à la balle au coeur ?
Mais en antithèse, ce que les splendides trilogies dramatiques de Dante Gatti – Le Poisson Noir, La vie d’Auguste G., Sacco Vanzetti, réfléchies dans La Parole errante – seraient au grand triptyque philosophique qui était cher à Neda : Descartes, Nietzsche, Avicenne, prolongé par Sohravardi.
A travers le triptyque que travaillait Neda, dans Téhéran soudain enflammée par la provocation du mensonge électoral, le monde entier peut désormais entendre le propos cinglant du Zarathustra nietzschéen : “l’Etat, c’est le plus froid de tous les monstres froids, il ment froidement, et voici le mensonge qui suinte de sa bouche : moi, l’Etat, je suis le peuple..”
Le visage de Neda dessine la limite où un peuple cesse de supporter le mensonge d’Etat.
Jean Pierre Faye
1er août 2009